
Agriculture : alerte rouge sur la Côte d’Azur

« Pour que la France rayonne, elle doit offrir un visage humain, libéral, mondialiste et moderne. » Propos de Valéry Giscard d’Estaing le 31 décembre 1975 à l’occasion de ses vœux présidentiels (image du documentaire « Tu nourriras le monde »).
1975 : fin (théorique) des malnommées « Trente Glorieuses », période de reconstruction post-guerre, de développement et de croissance effrénée (près de 6% par an jusqu’au 1er choc pétrolier de 1973 !)
Cette vision libérale et mondialiste a très largement concerné et impacté l’agriculture française. Et si elle a répondu à la forte demande des années après-guerre, elle pose aujourd’hui d’immenses problèmes et défis, tant à la population agricole que vis-à-vis de l’environnement et de la santé publique.
Une succession (trop) rapide de révolutions agricoles
Alors que les pratiques agricoles étaient restées, peu ou prou, inchangées depuis des siècles, notre pays a connu plusieurs « révolutions agricoles » sur les dernières décennies. La première, à partir du XIXème siècle a été fondée sur la « révolution fourragère » (modification des assolements (succession et alternance de cultures sur un même terrain pour conserver la fertilité du sol), passage de prairies permanentes à des prairies semées) et sur la « révolution de la mécanisation », dans le droit chemin de la « révolution industrielle ».
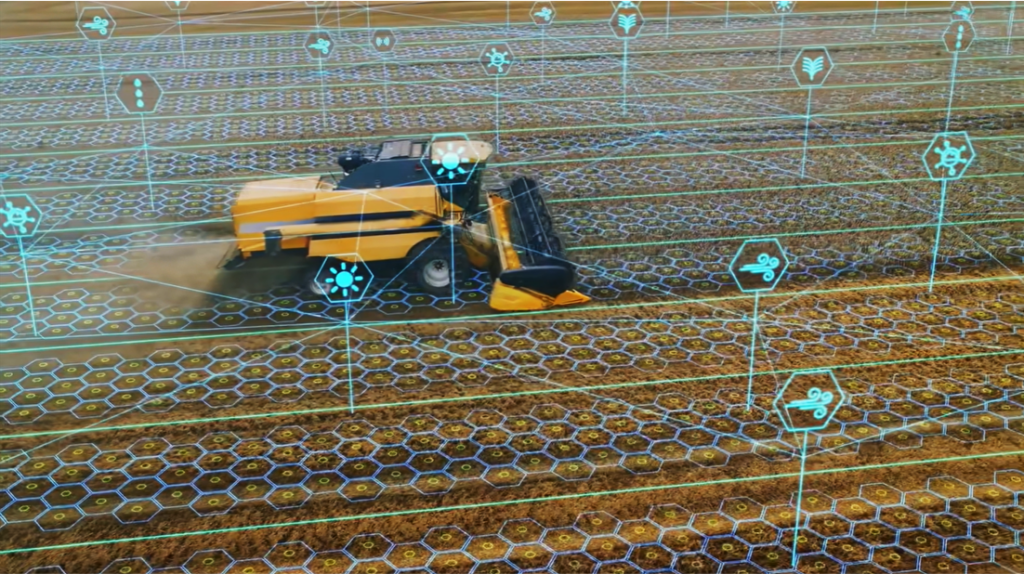
Agriculture productiviste et capitalisme agricole étaient lancés. Cette dynamique a été baptisée « révolution verte » dans les pays en voie de développement. Mais aujourd’hui, cette révolution n’a plus grand-chose de vert… (image du documentaire « Tu nourriras le monde »).
En France, le paysage agricole a été profondément remanié, au nom de la modernisation et du progrès, avec les remembrements fonciers (loi Pisani, 1962), la très forte augmentation des surfaces et la concentration des exploitations, le défrichage et l’arrachage des haies, pourtant havres de biodiversité, la mécanisation à marche forcée (initiée avec le fameux plan Marshall étatsunien ou Foreign Assistance Act, 1948), le déploiement de l’irrigation, l’apport massif des intrants industriels (chimie organique (engrais) et de synthèse, pesticides, dits « produits phytosanitaires »), et enfin l’appel à la génomique (sélections variétales, cultures biotech, hybridation, OGM) et aux technologies numériques (GPS, observations satellitaires). Cet ensemble de changements s’est révélé extrêmement performant, répondant pleinement aux attentes de la Politique Agricole Commune européenne (PAC) et induisant une telle amélioration des conditions de vie, que la démographie a connu un bond inédit à partir des années 1960 (Baby-Boom). Rapidement, le nouveau modèle agricole est devenu surproductif et excédentaire, rendant nécessaire l’écoulement des stocks à l’export.
L’ultralibéralisme a jeté l’agriculture dans l’arène du troc international
Après une phase de régulation (prix agricoles garantis et subventions) puis de quotas de production, les protestations (pour concurrence déloyale et dumping) des pays membres du GATT (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, avant la création de l’OMC – Organisation Mondiale du Commerce, 1995) et participant au « cycle d’Uruguay » (1986-1994, libéralisation des échanges internationaux), ont entraîné une dérégulation massive avec, in fine, une mise en concurrence brutale des producteurs agricoles français avec ceux des pays à bas niveau de revenu: le troc agricole et la spéculation sur les matières premières ont alors mis à rude épreuve nos paysans, devenus des exploitants agricoles, directement soumis aux diktats des marchés.

La règle d’or de l’ultralibéralisme, et de ses accords de libre-échange (TAFTA, CETA (depuis 2017), Mercosur, etc.) est la suivante : si je veux te vendre des Airbus, des voitures ou des armes, je dois en retour accepter de t’importer des produits, notamment agricoles. Et donc réduire mes propres productions (image du documentaire « Tu nourriras le monde »).
Prix volatils, pression croissante des industriels et des distributeurs, envolée des prix du foncier, endettement, s’ajoutent ainsi au péril climatique (sécheresse, canicule, épisodes météorologiques violents), qui lui-même est corrélé à un productivisme extractiviste et mondialisé, très émetteur en gaz à effet de serre (près de 40 milliards de tonnes par an actuellement, qui s’ajoutent aux 2500 milliards de tonnes déjà émises depuis la révolution industrielle, à l’origine du réchauffement climatique).
Même l’ancien ministre de l’agriculture Edgar Pisani, l’un des fondateurs de la PAC européenne, a jugé que si cette PAC avait toute sa justification après-guerre, elle aurait dû être profondément remaniée dans les années 1990. Or, il n’en a rien été… La crise agricole de janvier 2024 n’aura fait que confirmer que tout est fait pour ne pas écorner le modèle ultralibéral mondialiste, les négociations mettant même à mal les normes de protection environnementale et sanitaire (mise en pause des jachères et du plan Ecophyto, relance des autorisations du glyphosate pour dix ans, déréglementation des OGM, etc.). Cette confirmation du vieux modèle s’est vue appuyée par la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles), un syndicat agroindustriel aux mains du grand patronat agricole (Arnaud Rousseau et le fameux « 1% contre les 99% »)…
Aujourd’hui, les lignes rouges ont été franchies. Les accords de libre-échange (ALE), tant vantés par les multinationales et les lobbies industriels et commerciaux, attaquent même frontalement les « barrières non-tarifaires », cherchant (souvent avec efficacité) à démanteler jusqu’aux normes environnementales et sanitaires. Le commerce d’abord, la santé après ! Quitte à ce que les multinationales attaquent les Etats, et ces accords leur en donnent la possibilité (mécanisme ISDS)… Lire le bilan contrasté des ALE ici.
Les dégâts du libre-échangisme et du productivisme agricole deviennent considérables
Mais comme toute médaille, cette révolution connaît ses revers. Et quels revers ! La plupart des experts l’affirment : le modèle est à bout de souffle.
Cette technicisation et cette course effrénée à la productivité ont entraîné une « course à l’échalote » à grande échelle (la fameuse « mondialisation néolibérale»), une mise en concurrence insupportable, et souvent déloyale, pour la majorité des paysans, tant en France que dans les pays pauvres de la planète, ainsi que des dégâts environnementaux, sociaux et sanitaires impressionnants : pollution généralisée (par la chimie de synthèse, les antibiotiques, les perturbateurs endocriniens, les nitrates, etc.), érosion et stérilisation des sols par les pesticides, herbicides et fongicides (et leurs métabolites), eutrophisation des cours d’eau (efflorescences algales) et pollution des nappes phréatiques, déforestation, perte massive de biodiversité (souterraine, végétale, animale, semencière), perturbation des cycles naturels (azote, phosphore, etc.). Sans oublier la paupérisation (près de 20% des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté !) et l’endettement d’un grand nombre d’agriculteurs, qui doivent se contenter de subventions européennes pour survivre, quand ils ne font simplement pas faillite ou ne mettent pas fin à leurs jours, les atteintes à leur santé (notamment lymphomes liés aux pesticides), l’exode rural massif qui a vidé les campagnes françaises, et l’apparition de gigantesques bidonvilles autour des mégapoles, dans les pays en voie de développement.
Les externalités négatives ont explosé (conséquences négatives non désirées de l’activité d’un acteur économique sur le reste de la société ou sur la planète). Dans un rapport de la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) publiée en novembre 2023 (Le Monde), il est expliqué que les coûts cachés (« True Cost Accounting ») de l’agroalimentation sur la santé et l’environnement sont a minima de 10.000 milliards de $ par an à l’échelle mondiale, soit plus de 10 % du PIB mondial. Ce taux grimpe même jusqu’à plus d’un quart du PIB pour les pays à bas revenus : une vraie catastrophe, qui se cache derrière son petit doigt.
Quelles pistes pour demain ?
Face à cette course à l’abîme, de plus en plus d’agriculteurs, et notamment de jeunes paysans, ont décidé de bifurquer, pour un nouveau modèle, soutenu et promu par la Confédération Paysanne (depuis 1987, cet acteur majeur du syndicalisme agricole français porte des valeurs de solidarité et de partage, aujourd’hui 3ème syndicat agricole français), et par le réseau de l’agriculture paysanne FADEAR.
Alors que le président Emmanuel Macron vante une nouvelle « révolution » (dans le cadre du plan « France 2030 »), après celle de la mécanisation et de la chimie, basée sur le triptyque « Numérique – Robotique – Génétique », ces nouveaux paysans souhaitent sortir le monde agricole de cette spirale technophile infernale et le ramener à des bases humaines, saines et durables.
L’enjeu de la transition écologique est gigantesque : attirer la jeunesse (à l’heure de départs massifs à la retraite) vers une agroécologie moderne plutôt que vers des emplois tertiaires ou fossiles, la former sur mille sujets : agroforesterie, sylvopastoralisme, polycultures, semences paysannes et techniques de semis, couverts végétaux (paillage, mulch, BRF), restauration et re-fertilisation des sols (sortie de la chimie de synthèse, relance de l’assolement diversifié, et séquestration du carbone) et des espaces naturels (haies, bocages, biodiversité), moins d’intrants, désherbage, élevage à taille humaine (bien-être animal), compostage. Et … cesser la folle artificialisation des terres arables : il faut urgemment les sanctuariser (loi ZAN). Le béton tue le potentiel agricole à jamais (juste un exemple : l’implantation de l’enseigne IKEA dans la Plaine du Var a détruit 4 hectares de terre particulièrement fertile).
Or les discours politiques sont à la récupération et au simplisme démagogique : des technocrates se font experts pour nous parler de réponses générales en vue de « sauver l’agriculture ». Alors qu’il existe plusieurs agricultures (céréales, maraîchage, élevage, arboriculture, apiculture, horticulture, etc.), chacune ayant ses spécificités et ses enjeux. Ce que nous attendons de ces dirigeants publics, ce ne sont pas de petites phrases ou des slogans, mais c’est d’avoir le courage et l’audace de revoir le cadre général du secteur agroalimentaire, à l’échelle européenne et nationale. Un exemple : Olivier de Schutter, ancien rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, a proposé que les budgets et les subventions de la PAC soient fléchés vers les pratiques vertueuses plutôt qu’à l’hectare. C’est aussi de savoir préserver l’agriculture des dérégulations sauvages et des accords de libre-échange (voire les remettre en question, car ils sont antinomiques avec la transition écologique !), qui la mènent à la catastrophe, ou encore d’encadrer et réguler la chaîne de redistribution des valeurs ajoutées entre les producteurs, les industriels et les distributeurs, ces deux derniers acteurs accumulant aujourd’hui les marges les plus importantes. A titre d’information, la grande distribution française aujourd’hui, c’est 800.000 employés, plus de 2.000 hypermarchés et 10.000 supermarchés, et un chiffre d’affaires proche de 200 milliards d’euros !
Où en sommes-nous dans les Alpes-Maritimes ?

Notre département n’est pas comparable à la Beauce ou à la Champagne crayeuse. L’activité agricole y est minimale aujourd’hui et notre dépendance alimentaire a atteint un niveau critique : nous n’avons qu’1% de suffisance alimentaire. Autrement dit, nous ne sommes qu’à 3 jours de pénuries. Bloquez l’autoroute A8 et les magasins se vident sans délai… Nous avons une autoroute polluante pour cordon ombilical.
Alors que les Alpes-Maritimes comptent plus d’un million de résidents et qu’elles accueillent des millions de visiteurs chaque année, les besoins sont énormes. Et que font nos élus au pouvoir ? Eblouis par le soleil et l’argent, ils ne pensent que (sur)tourisme, hôtellerie de luxe, grands événements (Festival de Cannes, Formule 1, Carnaval, Iron Man, JO d’hiver 2030, etc.), smart city et BTP. Jamais, les terres fertiles de la Plaine du Var, à Nice, n’auront connu un tel déversement de béton que depuis que Christian Estrosi a lancé son Opération d’Intérêt National (OIN « Ecovallée ») en 2008 !
A Nice, et plus largement dans le département, on assiste à de l’électoralisme foncier (friches spéculatives), et à une déprise agricole hallucinante : 1/3 des exploitations agricoles ont disparu en 10 ans, et les agriculteurs de plus de 70 ans sont plus nombreux que ceux de moins de 30 ans. Près de 8 exploitations sur 10 ont une surface de moins de 2,5 hectares. En bref, peu de SAU (surface agricole utilisée) et beaucoup de bouches à nourrir… Mais vous comprenez, le principal, c’est que l’aéroport de Nice déverse ses presque 15 millions de passagers chaque année sur nos beaux hôtels !
Les Alpes-Maritimes sont aujourd’hui le département le moins agricole de France
Non seulement, nous mangeons, mais nous dévorons les terres. Autant dire que l’agriculture est le dernier souci de nos dirigeants publics…
Une preuve supplémentaire ? Il existe un outil de référence pour développer et consolider intelligemment l’agriculture sur un territoire : le Projet Agricole Territorial (PAT). A Nice, il a été annoncé, après moult demandes du monde associatif et citoyen, en juin 2019, bien plus tard que de nombreuses autres métropoles (Lille, Lyon, Nantes, etc.). Cinq ans plus tard, en 2024, aucun PAT n’est officiellement mis en œuvre ! Pas davantage de succès du côté de la Politique Agricole et Alimentaire de la Métropole Nice Côte d’Azur, décrétée en 2014 : aucun résultat tangible non plus, 10 ans plus tard, en dépit d’un budget de 18 millions d’euros sur 6 ans… Beaucoup d’annonces et de com’, pour un bilan catastrophique. Le tourisme, l’immigration et les caméras de surveillance « intelligentes » sont visiblement des sujets plus captivants.



Au bilan, la région niçoise se trouve en situation d’insécurité alimentaire maximale. Le nouveau Préfet des Alpes-Maritimes, Hugues Moutouh, semble avoir compris que cette folie bétonnière ne pouvait plus durer, décrétant, en novembre 2023, une Zone Agricole Protégée (ZAP) de 270 hectares, soit moins de 3% de la superficie de la Plaine du Var… Ajoutons que le pourtour méditerranéen est un hot spot du réchauffement climatique : nous devrions connaître une diminution de la pluviométrie (sécheresses, perte d’enneigement du Mercantour), une augmentation des canicules et des événements climatiques extrêmes (de type Alex), qui rendront l’agriculture encore plus vulnérable dans les décennies à venir.
Exprimons-nous, mobilisons-nous !
Nous autres, citoyen-nes, nous avons évidemment notre avis à donner, puisque nous passons à table trois fois par jour, et le « bon bulletin » à mettre dans l’urne. Nous avons tout intérêt à nous mobiliser fortement collectivement, et à faire les bons choix individuellement. Acheter, autant que possible, des produits locaux et de saison, bio, auprès des producteurs locaux (les AMAP, par exemple), plutôt que chez les grands distributeurs.
C’est tout bénéfice pour nos paysans, pour notre sécurité alimentaire et pour la santé des humains et des écosystèmes !
Quelques conseils (vraiment !) :
- Documentaire « Tu nourriras le monde » de Floris Schruijer & Nathan Pirard, ingénieurs agronomes
- Documentaire « Du Béton sur nos courgettes », d’Arnaud Gobin & Christophe Camoirano
- Article « Une vraie souveraineté alimentaire pour la France » d’Harold Levrel, professeur d’économie écologique à AgroParisTech (The Conversation)
- Article « Décrypter le mouvement des agriculteurs », entretien avec Morgan Ody, paysanne, 30 janvier 2024
- Article « Voilà ce qui tue (vraiment) les agriculteurs », newsletter d’Hugo Clément, 31 janvier 2024
- Article « Les lobbies agroalimentaires contre la santé publique » de François Bourdillon, 2005
- Article « Des lobbies s’opposent à près de la moitié des propositions émises par le Conseil national de l’alimentation », France Info, 2023